Pendant la Seconde Guerre mondiale, la
campagne
de France
[ou bataille de France] désigne l'invasion allemande des
Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de la France en 1940.
L'offensive commence le 10 mai 1940 en mettant fin à la
«
drôle de guerre », et se termine le 22 juin par la
défaite des forces armées françaises
et la
signature de l'armistice du 22 juin 1940 par le gouvernement
Pétain.
Le territoire des quatre pays est alors
occupé selon différentes modalités,
principalement
: une zone occupée par l'Allemagne au Nord et à
l'Ouest,
une zone occupée par l'Italie dans le Sud-Est et une zone
libre
sous l'autorité du gouvernement de Vichy .../...
Au cours
de la campagne de France (mai-juin 1940), 1 800 000 soldats de
l'armée française sont capturés par
les troupes
allemandes avant d'être internés dans
différents
types de camps. Un grand nombre de prisonniers tentent de
s'évader, 70 000 réussissant sur l'ensemble de la
période, sans compter ceux évadés
dés les
premiers mois avant leur transfert vers l'Allemagne.
D'après l'encyclopédie Wikipedia, article
bataille
de France
La Mobilisation
à
Rânes
Nous ne pouvons définir
combien de Rânais sont partis sur le front. En effet, les
archives ont brûlé avec la Mairie à la
Libération. De ce fait, aucun document officiel local ne
peut être retrouvé. Toutefois, nous pouvons
estimer ce chiffre à 70 voire 100 personnes.
La France et l'Angleterre ont déclaré la guerre
à l'Allemagne le 3 septembre 1939 juste après que
celle-ci ait envahi la Pologne. Cette déclaration, les
Français l'attendaient et avaient déjà
mobilisé depuis le 26 août, se rappelle Mme
Bisson. Elle se souvient aussi que les soldats n'avaient pas peur de
partir. En effet, ils avaient déjà
vécu en 1938 les "périodes" : c'étaient
des mobilisations d'où ils revenaient au bout de 4
à 5 jours. Ainsi, ils pensaient revenir quelques jours
après. Mais cette fois-ci, c'était la bonne.
Toutefois, le moral n'était pas mauvais durant les premiers
mois de mobilisation bien que la tension montât dans les
rangs. En
effet, les soldats ne se sont pas battus pendant les 6 premiers mois.
Les soldats n'ont donc commencé à se battre que
vers février-mars 1940. Mais après une attaque
foudroyante par la Belgique, une partie des troupes
françaises, dont M. Ferrand et M. Bisson firent partie, est
encerclée dans le nord de la France. Ces soldats embarquent
pour la Grande-Bretagne d'où ils ont tout de suite
été réembarqués pour le sud
de la France. Mme Bisson raconte que son mari a vécu un
moment dans le Gers, puis est revenu à Rânes
après les moissons en septembre 1940. Il est donc
resté à Rânes durant toute la guerre
car il n'a pas été fait prisonnier en revenant au
pays. Par contre, la majorité des Rânais
mobilisés furent pris dans les filets allemands et sont
faits prisonniers. Parmi ceux-ci, il y aura M. Charles
Sérée et M. Violet qui revinrent ensuite
grâce à la "relève". Mais tous les
autres
ne rentreront au pays qu'en 1945 voire 1946-1947 après leur
libération en Allemagne.
Extrait de :
Claire Forget, La vie
quotidienne durant la deuxième guerre mondiale dans le
village de Rânes, 1939-1945. Mémoire
de DEUG (Histoire), Université de Caen, 1995. p. 2.
La défense passive et la
garde territoriale
La Normandie craignait une invasion aérienne, aussi de
nombreuses mesures furent prises pour protéger l'habitant:
liste des caves capables d'abriter des personnes en
détresse, réglementation de
l'éclairage, toutes les voitures devaient se munir de phares
bleus. Cependant Rânes fut moins sujette à ces
préoccupations. D'une part très peu de
Rânais possédaient une voiture ; seuls quelques
commerçants comme André Duval, un des boulangers
de la commune. De plus comme ces mesures ont été
poursuivies durant les années de guerre, cela n'a pas
marqué les esprits. D'autre part, Rânes est une
commune rurale et de faible importance : elle passe plus facilement
outre aux réglementations.
Pour ce qui est de la défense territoriale, "
avant que les Allemands arrivent
le maire avait mobilisé les personnes valides pour
construire des barrages." C'est la seule allusion qui me
fut rapportée des mesures prises par la localité
de Rânes pour faire face à un éventuel
assaut Allemand. La personne qui m'a relaté cette anecdote
ajoute qu'elle n'y est restée qu'une matinée.
Tout ceci démontre qu'on ne s'attendait pas à ce
que les troupes ennemies passent dans le département.
Cette garde territoriale semblait être une perte de temps.
Pour beaucoup, les valides étaient plus utiles aux travaux
des champs. C'est la raison pour laquelle les Rânais ne
furent pas marqués par ces mesures de protection et de
défense. Après les premiers assauts des Allemands
(mai et juin 1940), les Rânais furent plus
préoccupés par le flux humain qui passa dans le
bourg.
Extrait
de : Jean-Philippe Bignon,
Rânes pendant la
seconde guerre mondiale
Mémoire (Histoire), Université de Caen, 1994. p. 6
Des Rânais craintifs
Dès la déclaration de guerre, certains
Rânais ont déjà mis en place une
réserve. La mère de Suzanne Duval, à
la suite de la mobilisation, commence déjà
à amasser dans sa cave des produits de première
nécessité - boites de conserves en tout genre -
et autres. C'est la peur de la pénurie à l'image
de celle de 1914-1918, qui réapparaît.
A cela s'ajoute un climat de crainte. On a peur de ces tyrans, de ces
violeurs Allemands dont les rumeurs des réfugiés
faisaient état. Durant les deux premières
semaines de juin, certains Rânais pensent quitter la commune.
André Duval a déjà rempli de conserves
le coffre de sa voiture lorsqu'il apprend, à la T.S.F., que
les Allemands sont tout proches ; il sera sûrement
rattrapé quel que soit l'endroit où il aille. Ne
sachant où aller et craignant les pillages de son magasin et
de ses biens la famille Duval reste à Rânes.
De nombreux bruits courraient la campagne, cependant peu de
Rânais quittèrent la commune, et si même
l'avancée allemande était connue par certains,
tous furent surpris par le passage des troupes ennemies le 17 juin 1940
dans le bourg de Rânes.
Extrait
de : Jean-Philippe Bignon,
Rânes pendant la
seconde guerre mondiale
Mémoire (Histoire), Université de Caen, 1994. p.
7
L'avion tombé près de Lignières-Orgères en juin 1940
« Le
11 juin 1940 un avion anglais, un bimoteur, est abattu par la DCA
allemande. Il a été vu en feu au dessus de Rânes
avant de venir s'écraser à quelques centaines de
mètres du bourg d'Orgères. Les cinq occupants sont
tués et carbonisés. Ils étaient âgés
de 18 à 28 ans. Les corps des aviateurs sont restés sans
sépulture jusqu'en août où il furent inhumés
au cimetière de Lignières. »
Source : récit de Marcel Langris sur le
site de Lignières-Orgères, v. également
ici« Mardi
11 juin, la nuit est tombée. Soudain, on entend un bruit de
moteur d'avion. On sort de la maison et l'on aperçoit un
appareil qui paraît en difficulté : il vient
approximativement de la direction de Ciral ; des lueurs sortent et l'on
distingue des crépitements. Il semble perdre de l'altitude puis
disparaît, une grosse explosion se produit puis plus aucun bruit.
L'avion est-il allemand ? A-t-il lancé des bombes à
retardement (il en était beaucoup question) ? C'était
aussi une époque où l'on était peu
familiarisé avec les avions... On le sera plus tard !
La
nuit passe. Le mercredi matin, on apprend qu'un avion est tombé
à La Boulardière [à proximité du bourg
d'Orgères], qu'il est anglais et qu'il en reste peu de choses.
Il gît au milieu de la route, juste avant l'embranchement vers ce
village ; les membres de l'équipage sont carbonisés. Il
se dégage une drôle d'odeur de cette épave en
grande partie brûlée ; un parachute en triste état
est accroché à une "rousse" située dans la haie
à proximité de l'épave, et une aile a
été projetée par l'explosion près de La
Brousse.
Cet avion fut gardé pendant quelques jours par des
soldats français puis abandonné à son triste sort
pour cause de retrait.
Les Allemands occupant Lignières
assurèrent la sépulture des restes des cinq aviateurs en
les enterrant au cimetière à l'emplacement où ils
sont actuellement. Les croix, en bois, portaient l'inscription suivante
:
Hier Ruhen 5 Engliche flieger (
Ici reposent 5 aviateurs anglais).
Nous ne disposons pas de clichés. Quant à l'épave, des Allemands l'ont évacuée. »
Source : André Robert et Christian Ferault, bulletin municipal de Lignières-Orgères
La présence d'une DCA allemande dans le secteur Rânes-Carrouges-Lignières dès le 11 juin 1940
pose problème. En effet, selon les récits d'André Soubiran et du
capitaine de Roys (voir ci-dessous), les Allemands ne seront présents dans la
région que quelques jours plus tard. Ils sont entrés en Mayenne ainsi
qu'à Rânes le 17 juin.
Nous avons retrouvé les éléments suivants :
« Pour marquer l'entrée des Italiens dans la guerre, 36 bombardiers
Whitley V des escadrons
n°
10, 51, 58, 77 et 102 ont été chargés de bombarder
Gênes et Turin pendant la nuit du 11 au 12 juin 1940. Seuls
13 avions ont effectivement atteint leurs objectifs en raison d'une
combinaison de conditions météorologiques
défavorables et d'incidents de moteurs.
Type: Whitley Mk.V
N ° de série: N1362, KN-?
Opération: Turin
Disparu le 11.06.1940
- Sergent
(Pilot) Norman M. Songest, RAF 580330, 77 Sqdn., âge inconnu,
11.06.1940, cimetière communal de Lignières-Orgères, F
- Sergent
(Pilot) Philip HJ Budden, RAFVR 742113, 77 Sqdn., 26 ans,
11.06.1940, cimetière communal
de Lignières-Orgères, F
- Sergent (Obs.)
Alexander Findlay, RAFVR 749540, 77 Sqdn., 28 ans,
11.06.1940, cimetière communal
de Lignières-Orgères, F
- Sergent (W.Op. /
Air GNR.) Ronald C. Astbury, RAF 630781, 77 Sqdn., 20 ans,
11.06.1940, cimetière communal
de Lignières-Orgères, F
- Sergent (W. Op.
[Air]) Edward Ombler, RAF 633791, 77 Sqdn., 18 ans,
11.06.1940, cimetière communal
de Lignières-Orgères, F
Parti
de l'aéroport de Jersey. Au retour, l'avion s'est
écrasé à 22 h 30, en flammes, près de
Lignières-Orgères (Mayenne) à 10 km au nord de
Pré-en-Pail, France.
La cause de la perte n'est pas établie. »
Source :
Traces of World War 2 - Royal Air Force, Battle of France 1940 and start of the Strategic Air Offensive against German
Il
est donc très vraisemblable que l'avion s'est
écrasé à cause d'une avarie et non à la
suite d'un tir de DCA allemande. Et il est peu probable qu'il ait
été vu de Rânes bien que plusieurs Rânais
soient venus voir l'épave.
Normandie – 17 Juin 1940
André
Soubiran, J'étais
médecin avec les chars, journal de guerre
[
Le lieutenant Soubiran
était affecté comme médecin auxiliaire
au 3ème Régiment
d’Auto-Mitrailleuses (3ème RAM). Le livre est un
journal de guerre, commencé en 1941 et terminé en
juin 1942, décrivant la Campagne du Régiment du 9
mai au 18 Juin 1940. Des difficultés de papier en
empêchèrent la publication jusqu’en
avril 1943. La Préface de Georges Duhamel et la
dédicace au Chef d’escadron Jacques Weygand, le
fils du Général Weygand, le firent interdire en
zone occupée par la censure allemande
jusqu’à l’attribution, en 1944, du prix
Théophraste Renaudot.]
[ …] A quinze heures, la brigade tout entière
revenait en position vers l’est pour barrer la route
à la progression allemande.
Le P.C. du régiment s’établit au
nord-est de La Ferté Macé, à
Saint-Georges-d’Annebecq, en point d’appui avec
deux batteries de 75.
Les escadrons Weygand et Rouzée prirent position
à Rânes, un peu plus en avant, avec une section de
75 et le peloton de chars de Maugey [
note 1].
Un bataillon de dragons portés s’installa vers le
nord et le peloton Madelin tint l’axe La Ferté
Macé-Carrouges au sud.
Vers cette ligne d’îlots de résistance
on voyait de toute parts progresser les blindées allemandes
avec des fanions blancs. Entre leurs lignes d’acier
tournoyaient des détachements français errants,
déjà vaincus, des réfugiés,
fous de terreur, en multitude vagabonde, qui semblaient ne savoir
où aller, et la foule des prisonniers
désarmés et renvoyés, sans leurs
officiers, par l’adversaire. Une confusion extrême
régna ainsi, en dépit de laquelle des combats
acharnés eurent lieu jusqu’au soir, entre les
villages en feu et les chemins jonchés de cadavres.
Vers le sud brûlait Carrouges, où se battaient les
dragons portés du capitaine de Royère soutenus
par les chars de Madeline.
Entre Carrouges et Rânes, le lieutenant Dattez avec ses
dragons prenait à partie un détachement
porté allemand et l’anéantissait.
Devant Rânes, quelques dragons blessés au cours de
furieux combats à pied entre Vieux-Pont et Saint-Brice,
rendaient compte au capitaine Weygand de la présence sur le
lieu du combat d’une importante colonne
d’infanterie portée allemande qui semblait se
préparer à avancer.
Maugey reçut l’ordre de s’y porter avec
ses trois chars et de harceler cette colonne en agissant sur son flanc,
quand elle passerait à bonne distance.
Il s’approcha de la colonne, la repéra et, au lieu
de se maintenir à bonne portée et
d’agir de loin par le feu de ses canons, avec prudence, il la
remonta pour la surprendre par derrière.
Alors il se rua sur les camions à demi-blindés
bondés d’uniformes verts et
d’où venaient des chants. Presque à
bout portant il envoya son premier coup sur le camion le plus proche.
Touché en plein, tout sauta, dans une explosion de
métal et de chair qui s’éparpilla en
bouquet au milieu de hurlements.
Avant que les autres aient eu le temps de riposter ou de fuir, il
remonta la colonne, deux chars d’un
côté, un de l’autre, il la coupa, la
bouscula en tout sens, abattant à la mitrailleuse ceux qui
essayaient de s’échapper, crevant les
réservoirs, et, pour finir, il l’incendia
à coups de canon.
Lorsqu’il eut épuisé ses munitions, la
longue file des quarante camions n’était plus
qu’une chenille de flammes où grillaient des
cadavres, la route était obstruée pour longtemps
et le bataillon à jamais hors de combat.
Maugey n’avait même pas gardé un obus,
un chargeur, pour protéger son retour. Et, dès
qu’il eut refait sa provision de munitions, il repartit pour
un nouvel accrochage.
Cet après-midi, il fut encore
l’héroïque chef de peloton à
figure d’enfant, défiant la mort, ne demandant
qu’à se battre, ignorant la fatigue et la peur,
allant partout à plein cœur, plein
élan, pleine chance, symbole de la richesse de ces jours
où la fleur d’une jeunesse commanda
héroïquement avant d’avoir
commencé à vivre [
note 2].
Cet après-midi du 17 juin, une fureur sacrée
anima le régiment. A aucun moment la violence de la bataille
ne s’épuisa, elle se maintint
jusqu’à la fin, rapide, farouche,
désespérée.
Cet après-midi il n’y eut plus de printemps, plus
de haies vertes, plus de ciel bleu, plus de murs
étoilés de roses. Il n’y eut plus
qu’un régiment jeté en avant,
déchaîné, hors d’haleine,
éperdu et fou, qui voulait combattre et combattre encore.
Il n’y eut plus que la bataille à un contre dix,
l’incendie et la mort à rendre au centuple pour la
France qui se mourait, assassinée !
Pendant cinq heures les auto-mitrailleurs, les dragons
portés avaient interdit toute avance sur le secteur qui leur
avait été confié.
Vers vingt heures arriva l’ordre de repli vers le sud-ouest.
Sur Rânes, l’ennemi tellement stoppé ne
réagit guère et le décrochage fut
facile.
Mais au nord-ouest, le bataillon Henriet avait lutté
farouchement sur ses points d’appuis. L’infanterie
allemande s’était collée à
lui, s’infiltrant de tous côtés,
résistant à chaque tentative de
dégagement, et le tenant sans cesse dans un
réseau dense de feu. Les dragons avaient eu de lourdes
pertes et c’est d’eux que nous vint le dernier
blessé de cette journée. Leur
décrochage ne put se faire qu’au prix de durs
combats.
Pour protéger notre repli et tenir La Ferté
Macé qui était au centre de toutes les routes du
pays, le peloton de chars Depret et le peloton moto Tunzini furent
désignés. Ils devaient garder à eux
seuls les issues de la ville et ensuite se porter chacun par un
itinéraire sur notre flanc gauche.
Ainsi cette après-midi du 17 juin, commencée sous
des ombres épaisses de souffrance, de
débâcle et de forces défaillantes, se
terminait sur un rayon de foi et d’espoir. […]
[
note 1 du site ranes1944.org]
Certains Rânais se souviennent d'un canon français
positionné dans la rue des Escholiers, près de l'ancien
presbytère ou de l'École des Garçons,
pointé dans la direction de la rue d'Écouché.
[
note 2 d'André Soubiran] Le sous-lieutenant Martin Maugey, déjà
cité à l’ordre de
l’armée en Luxembourg, captif depuis juin 1940, a
reçu à vingt ans la croix de Chevalier de la
Légion d’Honneur.
[
L’unité
se replie à travers la forêt d’Andaine,
traverse Juvigny-sous-Andaine et La Baroche durant la nuit. Le
regroupement de la colonne a lieu à
Céaucé. Elle se dirige ensuite vers
Saint-Fraimbault, fin de l’étape de repli. Le
3ème RAM est fait prisonnier le 18 juin à
Saint-Fraimbault. Le véhicule sanitaire de Lieutenant
Soubiran réussit à
s’échapper et à gagner Nantes.]
André Soubiran,
J'étais
médecin avec les chars... : journal de guerre
.
Première édition: Didier éditeur,
Paris, 1943. Prix Renaudot 1943
Extrait du chapitre
Normandie
- 17 juin 1940
Combats
de l'Orne de la
13ème Brigade Légère
Motorisée
Rânes/Carrouges/La
Ferté-Macé/Saint-Fraimbault en Juin 1940.
[...] Le capitaine de Roys et son escadron, qui a recueilli
tous ceux qui, venant de diverses unités, voulaient encore
se battre, sont devenus, d'escadron régimentaire de combat,
le principal soutien du commandant l'Hotte qui a pris le commandement
du 3° RAM depuis la bataille de la Somme, se montrant le chef
le plus capable, le héros le plus exemplaire et le plus
charismatique de ces journées de la fin de la campagne de
France. Ce seront les nouveaux combats de l'Orne, où
l'état major de la 13° brigade demande encore de
monter une contre-offensive de dégagement, pour soulager la
retraite de la X° armée. Elle sera
organisée à partir de Rânes, la petite
ville ornaise où le RAM s'était replié. Une batterie d'artillerie à deux pièces de 75,
venue des vestiges du 72° régiment d'artillerie
motorisée du lieutenant Colonel Thomas est
transformée en artillerie antichars [voir
note 1 ci-dessus]. Elle permet une
dernière fois de repousser les forces blindées
ennemies qui se présentaient au franchissement de la Rouvre.
Et c'est après ces journées de repli, avec le
soutien des escadrons de la 13° BLM, la chevauchée
en avant : Les derniers side et motocyclistes solos l'effectuent avec
leurs seuls mitrailleurs, en direction de Carrouges. C'est la
dernière action construite dans la Campagne de France,
conçue pour donner les heures de répit que
demandait le repli de la X° armée. Dans ce dernier
périmètre, le Colonel Lafeuillade a pu rassembler
autour de son escadron de commandement de brigade, l'escadron de Roys,
tous les débris des unités qui se battent au bout
de leurs forces. Autour de la Ferté
Maçé, où il a installé son
PC, il essaye de diriger les unités, du moins ce qu'il en
reste, de celles toujours déterminées
à combattre ; il essaye de les consolider sur la ligne
Argentan - Alençon ; le 16 juin, la 13° BLM recevra
même du général Pétiet,
l'ordre de tenter le passage de l'Orne de Sées à
Argentan, afin de permettre le décrochage du corps
d'armée Dufour, essentiel pour le repli de la X°
armée. Mais la manoeuvre du corps d'armée Dufour,
souvent gênée par les encombrements des colonnes
interminables des réfugiés, est mal
exécutée. Elle laisse s'ouvrir une
brèche, où le gros des blindés
allemands et de leur infanterie motorisée va pouvoir
s'engouffrer. C'est la fin. Il n'y a plus ni hommes, ni
matériel ni munitions. Le 3° RAM, ses derniers
escadrons Pigaud, Weygand, Kaminski et Rouzée,
aidés du peloton de chars Maugey, les dernières
unités disponibles de la 13° BLM avec l'escadron de
Royère et le peloton Madeline, doivent se replier vers
Saint-Fraimbault où les Allemands et leurs troupes
fraîches, sont parvenus en nombre et en force, pouvant enfin
les encercler. Il n'y a aucun espoir de briser de jour ce cercle
d'acier pour tenter de retrouver la 13 BLM. Le colonel Lafeuillade et
l'escadron de Roys sont à leur tour isolés dans
leur PC de la Ferté Maçé. Le
commandant l'Hotte, sans ordre, doit alors se résoudre
à la reddition, pour sauver le sang des rares
rescapés: L'aube du 17 juin se lève dans ce
village de Saint-Fraimbault devenu totalement silencieux. Le commandant
l'Hotte s'enquiert de l'état de ses soldats, les postant
dans des conditions aussi sures que possibles. 17 juin, douze heures
trente, le discours radiophonique du Maréchal
Pétain s'adresse aux français : "C'est le coeur
serré que je vous dis aujourd'hui, qu'il faut cesser le
combat… ". [...]
Source :
Société
des Amis de Saint Ange, biographie du Lieutenant-Colonel
René de Roys
L'exode
des militaires
M. Roger Jouvet et M. Marcel Claude sont partis sur les
chemins de l'exode. M. Jouvet raconte : "Etant militaire en sursis,
c'est-à-dire appartenant à la "classe 40"
(né en 1920), j'étais donc trop jeune pour
être appelé sous les drapeaux. Mais je devais me
mettre à la disposition de la gendarmerie. Les Allemands
approchant d'Argentan, j'ai reçu, avec quelques camarades,
l'ordre du Capitaine Weygand (fils du Général
Maxime Weygand), commandant les troupes françaises
retranchées à Rânes, de partir vers le
sud pour échapper aux mains des soldats allemands. Nous
sommes donc partis, mais avant Fougères, à Le
Loroux, à 100 km de Rânes en direction de Rennes,
nous nous sommes trouvés en face de divisions allemandes.
Nous avons donc décidé de faire demi-tour et de
rentrer à Rânes". Par ces faits, nous constatons
que les Allemands ont envahi extrêmement vite le territoire
français et que les militaires n'ont pas eu le temps de se
replier.
Les témoignages confirment qu'il y a eu des militaires
à passer ; mais ceux-ci ne disaient rien sur la
défaite au nord.
Les appelés à aller se battre à la
suite de la déclaration de guerre du 3 septembre 1939 dans
leur grande majorité ont été faits
prisonniers et ne sont rentrés à Rânes
qu'après la guerre en 1945.
Extrait
de : Claire Forget,
La
vie quotidienne durant la deuxième guerre mondiale dans le
village de Rânes, 1939-1945. Mémoire
de DEUG (Histoire), Université de Caen, 1995. p. 3
Récit de Louis Ravez,
prisonnier à Rânes en 1940
LA CAPTIVITE
Le
18 juin 1940, il était 15 heures 30 quand nous avons
été faits prisonniers à Antrain (qui
se trouve en
bas de la presqu'île du Cotentin). De là on nous
conduisit
à Bazouges-la-Pérouse. Nous étions
gardés
par les Allemands dans une pâture et il pleuvait des cordes.
Le
19 au soir départ pour Saint-Fraimbault-sur-Pisse :
arrivée à deux heures du matin. Le 22
arrivée
à Alençon au quartier Valazé. Dans
cette caserne
de cavalerie nous étions environ 20.000 ; la plupart
Français et quelques Anglais. Nous couchions à
même
les pavés, dans les écuries. Comme nourriture, un
brouet
clair.
CULTIVATEUR DANS L'ORNE
Par la suite, le
préfet de l'Orne ayant eu l'autorisation d'avoir des
prisonniers
pour rentrer les moissons, un certain nombre de prisonniers sont
partis. A ce moment j'ai trouvé un lit (une paillasse) dans
une
chambrée où nous étions une vingtaine
de
sous-officiers. J'étais le seul d'entre eux à
penser que
la guerre n'était pas finie. Pourquoi ? Je ne pouvais le
dire
mais j'en avais la certitude ? Dès l'instant où
j'ai
été pris par les Allemands, j'ai pensé
: Vous
m'avez mais vous ne m'aurez pas toujours. Environ un mois
après
les premiers départs en culture, avec un autre sergent-chef,
nous avons demandé à aller en culture. Nous avons
été conduis à Rânes dans
l'Orne.
Le
maire m'a désigné pour aller chez un cultivateur
:
celui-ci n'avait pas été mobilisé. Il
pensait
faire une affaire avec un travailleur qu'il n'aurait pas fallu payer.
Il n'avait pas demandé un prisonnier par charité
ou
patriotisme. Il disait : "Ici on mange bien mais on travaille !" C'est
là que j'ai passé les plus mauvais moments de ma
captivité.
Les foins étaient coupés à
la faucheuse. Nous retournions l'herbe pour la sécher au
moyen
d'une faucille et d'un bâton. On commençait au
début du champs, courbé en deux ; et au bout du
champ,
nous repartions en sens inverse. Faîtes cela toute la
journée et vous m'en direz des nouvelles. J'avais les reins
cassés. A cause de la pénurie de ficelle, les
gerbes
étaient attachées avec de la grosse corde
à
attacher les vaches. Les gerbes étaient très
lourdes.
Piquer les gerbes à la fourche pour les présenter
sur le
chariot était très fatiguant. Je gagnais bien ma
nourriture.
Quand les foins furent terminés, le
cultivateur me fit scier du bois, et par la suite il demanda aux
Allemands de me récupérer. Le coiffeur de
Rânes
[Charles Sérée], un célibataire,
à qui je
disais que le cultivateur voulait me faire rentrer au camp me dit "va
donc chez Léger, il te prendra". En effet cet ancien
combattant
de 14-18 me prit et avec son fils âgé de 18 ans;
je
l'aidais dans les travaux : il me considérait comme son
fils.
Quand j'étais chez lui, ma femme est venue me voir quelques
jours et elle a été bien accueillie.
Après
les battages, les Allemands ont
récupéré les
prisonniers. Comme nous allions partir en Allemagne, le cultivateur
chez qui ma femme était venue m'a remis un colis dans lequel
il
y avait une lettre m'annonçant la naissance de Marie
Camille, le
3 janvier 1941.
[Le 7 janvier 1941, Louis Ravez est envoyé en Autriche]
 Louis Ravez - travaux à la ferme de
M. Léger probablement à la Haie-Roger
à Rânes
Louis Ravez - travaux à la ferme de
M. Léger probablement à la Haie-Roger
à Rânes
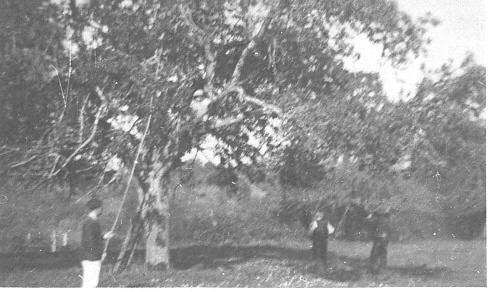 Louis
Ravez - travaux
à la ferme de M. Léger probablement
à la Haie-Roger à Rânes
Louis
Ravez - travaux
à la ferme de M. Léger probablement
à la Haie-Roger à Rânes
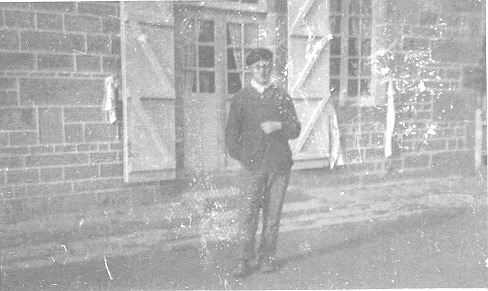 Louis
Ravez devant la
ferme de M. Léger probablement à la
Haie-Roger à Rânes
Louis
Ravez devant la
ferme de M. Léger probablement à la
Haie-Roger à Rânes
Source :
Albumverly,
site généalogique de Charles-Antoine Verly avec
son aimable autorisation. Voir aussi son
blog.
Une énigme... Tombes
de soldats SS
près de Rânes, août 1944 (?)
Tombes
de soldats SS
près de Rânes, août 1944 (?)
Photo de la
collection
du 1er Lieutenant Adrian E. Kibler sur le site de la
Third Armored Division.
Kibler était du
991st
Field Artillery Battalion attaché
à la
Third
Armored Division
du 25 juillet au début de septembre 1944. Le Bataillon
était équipé essentiellement de
pièces
d'artillerie de 155 mm M12 autotractées. Kibler
était
observateur de l'avant chargé de renseigner le Bataillon
depuis
un avion de reconnaissance.
Note
de Kibler : "Sept bons Allemands. Remarquez les "SS"
visibles sur
les deux tombes les plus proches. Ces tombes étaient bien
entretenues par les occupants allemands".
Il s'agit probablement de soldats tués en 1940 et dont les
tombes étaient entretenues par les troupes d'occupation. La
date
du début du conflit (1939) était
souvent mentionnée sur ce type de tombes.
Note
:
Nous ne possèdons aucun témoignage de
Rânais
concernant ces tombes, et il est possible que la localisation
mentionnée par le Lieutenant Kibler soit
erronée.
