Après la guerre, plusieurs prisonniers allemands ont
été employés dans certaines fermes ou
chez quelques artisans de Rânes. Ces prisonniers avaient
été internés dans un camp à
Damigny, près d'Alençon, et des civils ayant
besoin de main-d'oeuvre venaient les réquisitionner.
Le camp de Damigny était l'un des plus grands camps de
France avec plus de 20000 prisonniers.
cf.
Les
dépôts de prisonniers de guerre de l'Axe en mains
françaises
Voir également le document
L'utilisation
civile des prisonniers de guerre de l'Axe
Hermann Halter, originaire de Neidenstein près de
Heidelberg, a été fait prisonnier par les
Américains en 1944. Il a ensuite travaillé comme
prisonnier de guerre chez plusieurs patrons en Normandie jusqu'en 1948.
L'un de ses derniers patrons fut
Albert Sochon qui était serrurier et réparateur
de
machines
agricoles à Rânes. Hermann travaillait alors comme
menuisier-ébéniste. Il était
très apprécié et traité
à l'égal des autres employés.
Cela n'a malheureusement pas toujours été le cas
et certains se souviennent de vexations ou brimades envers les
prisonniers allemands. Dans une certaine ferme par exemple les deux
prisonniers ne partagaient jamais la table de leurs employeurs et
devaient manger en silence à l'écart sur une
petite table isolée.
Hermann est revenu à Rânes en 1966 pour rendre
visite à Albert Sochon ainsi qu'à plusieurs amis
français.
Hermann est décédé le 3 avril 1985.
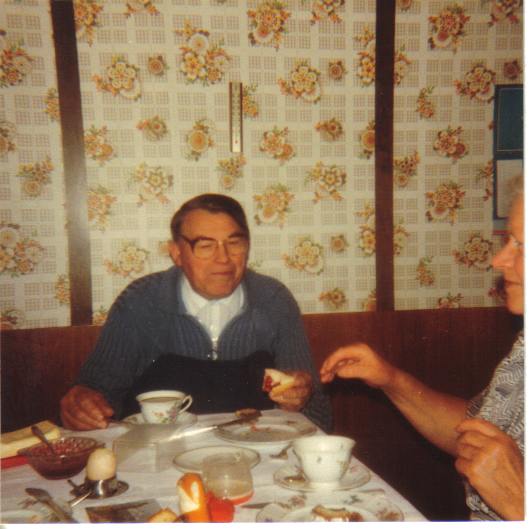
Photo
de Hermann Halter et de sa femme Anni à Neidenstein
dans les années 1970
Les prisonniers de guerre allemands
à Rânes en 1945
témoignage
de Jean Jaigu
Le nombre de soldats allemands
prisonniers en France en 1945 est estimé à
environ 750 000 personnes.
La
période d'emprisonnement en France s'est achevée
en décembre 1948.
Au-delà
de cette date, le gouvernement français a proposé
aux
Allemands de rester travailler en France avec un contrat de travail -
d'une durée d' un an - soumis au droit du travail
français.
"Plusieurs de ces prisonniers de
guerre allemands ont été employés
à
Rânes - en particulier dans les fermes - et
compensaient
par leur travail l’absence du fermier français
lui-même prisonnier de guerre en Allemagne (parfois
employé lui aussi dans une ferme).
Dans
l’environnement immédiat de l’ancienne
gare -
où mes parents avaient obtenu du Maire
l’autorisation de
s’installer provisoirement après
l’incendie,
causé par les combats de la Libération de notre
maison du
bourg (rue des Cinq Martin) - je pouvais voir, presque chaque jour en
allant chercher le lait, un de ces Allemands employé
à la
ferme Midy. Comme les valets de ferme français –
avant lui
et après lui - il couchait dans
l’écurie dans un
lit surélevé d’où
l’on pouvait
surveiller les juments au moment de pouliner. Pour nous, les enfants,
cet homme était facilement reconnaissable à ses
vêtements sombres et surtout à sa casquette
(militaire)
dont la forme ne ressemblait en rien à la coiffure que
presque
tous les paysans Rânais portaient à
l’époque.
A dire vrai, sans doute du fait des événements
que nous
venions de vivre et de ce que nous avions entendu dire sur les
«
boches »et leurs « têtes
brûlées
», cet homme nous faisait un peu peur et nous
tâchions de
passer le plus loin possible de lui quand nous l’apercevions
dans
la cour de la ferme. Il me donnait l’impression
d’être assez solitaire ; il faut dire que
la langue
devait déjà constituer pour lui un obstacle.
Je
crois me rappeler qu'un autre prisonnier allemand travaillait
également à la ferme Géray au Bois
Bellanger.
Mais
au ras de notre maison, nous avions aussi comme plus proches voisins un
groupe de prisonniers allemands employés au
déminage du
secteur."
En
France, la Direction du déminage dépendait du
Ministère de la Reconstruction et avait à sa
tête
Raymond Aubrac illustre résistant nommé
préfet
à la Libération. Au niveau local, le
déminage
était généralement organisé
par la commune.
Ce
sont 48 500 prisonniers allemands qui ont été
employés au déminage avec l'accord des
Alliés
(mais en contradiction avec la
Convention antérieure de
Genève).
Environ 3 000 Français se sont
portés volontaires pour assurer le déminage; ils
étaient attirés par un travail - assez difficile
à
trouver à l'époque - bien payé par
dessus le
marché (il est vrai que les risques étaient
grands).
Devant
l'autorisation donnée par les Alliés d'employer
des
prisonniers de guerre allemands pour cette tâche dangereuse,
le
rôle des démineurs français s'est
souvent
mué en encadrement des démineurs Allemands.
Les
chiffres d'accidents de déminage varient sensiblement selon
les
sources : 2 500 Allemands auraient été
tués
(soit environ 5% des effectifs employés) et 180
Français
(soit environ 6% des volontaires).
La fin de la période de déminage en France se
situe en décembre 1947.
"A
Rânes, ils devaient être une dizaine de
démineurs
allemands gardés nuit-et-jour par quelques
Français qui
portaient toujours le fusil à l’épaule.
Ils
logeaient dans un baraquement (en bois et couvert de papier goudron)
fourni à la France par les Américains du Nord
(Etats-Unis
ou Canada), du même modèle que ceux qui avaient
été alloués aux
établissements Claude qui
– au Ménil-Angot, derrière la Croix - y
avaient
installés leurs entrepôts de grains et
d’engrais
[Marcel Claude avait été chercher ces
baraquements
à Domfront].
Cette baraque avait été montée
au-delà de
la gare, à l’extrémité
nord-est du remblai
qui – avant 1940 - supportait les 2 ou 3 lignes de chemin de
fer.
Beaucoup d’autres baraquements – de forme
adéquate -
ont également servi pendant plusieurs années dans
le
bourg comme commerces et comme logements.
Le matin, ces
prisonniers passaient au ras de nos portes pour aller faire leur
dangereux travail; c’était bien avant que nous ne
partions
à l’école - qui commençait
alors à
9 heures - et je ne me souviens pas les avoir entendus nous
réveiller en passant. Dans la journée, ils
restaient sur
leur chantier de déminage et, le soir, ils rentraient
discrètement en rangs, toujours sous la surveillance
armée de leurs gardes français.
Chaque soir, et plus
rarement le matin (le jeudi et le dimanche -jours sans école
-
sans doute) il nous arrivait de passer devant le baraquement lorsque
nous allions conduire ou rechercher nos chèvres qui
– dans
la journée - étaient
enchaînées au piquet le
long de l’ancienne ligne (non loin du point de chute de
l’avion
américain)
et des chemins avoisinants. Il va de soi que nous passions rapidement
et « au large » pour les raisons
déjà
évoquées plus haut.
Certains soirs, ils
s’asseyaient le long de leur baraque –
côté
sud donc - et je me souviens que certains jouaient de
l’harmonica
(« bien! » selon
l’appréciation de mes
parents).
Mes parents discutaient de temps en temps avec les
gardiens mais je ne les ai jamais vu adresser la parole à un
« boche » comme j’entendais dire autour
de moi.
Puis
un jour, les prisonniers sont partis sans que je sache pourquoi (le
déminage du secteur était-il achevé ?)
et sans que
j’aie jamais entendu dire que certains aient
été ou
blessés ou tués en déminant.
Le baraquement
est resté vide pendant des mois (seuls les lits
superposés faits de planches de bois étaient
encore
visibles, au fond); nous les enfants allions y jouer car
c’était une grande aire de jeu
à l’abri
qui s’offrait à nous.
Il a encore servi pour y
organiser le repas de baptême d’une de mes
sœurs en
Octobre-Novembre 46 puis le repas de mariage du fils de notre voisin
Maurice Bisson. Il est d’ailleurs encore visible - pour celui
qui
se souvient de cette construction - sur la photo
aérienne de 1947 où l’on
aperçoit aussi l’avion américain.
Enfin,
un jour, on nous a dit que le baraquement avait
été
vendu; l’acheteur est donc venu le démonter. Mes
parents
ont eu l’opportunité d’acheter
l’ancienne gare
et de l’agrandir; des échanges de terrains se sont
faits
avec M Bisson notre voisin qui se plaignait de ne pas «
avouèr d’ieau pour ses vaches » (avoir
de passage
pour que ses vaches accèdent à la mare); les
clôtures de la ligne ont été
déplacées et réutilisées;
le remblai a
été débarrassé des quelques
ronces ou
arbustes qui commençaient à y pousser et le
passé
récent de l’ancienne gare avec le baraquement et
ses
prisonniers, le char allemand détruit, la canon anti-char
allemand Pak40 [voir photos dans La
bataille de Rânes-Fromentel], l’avion
américain, les haies
percées d’ouvertures pour laisser passer les
chars, les
tombes provisoires des Allemands… tout est peu à
peu
tombé dans l’oubli ou presque sauf pour les gosses
que la
guerre avait surpris et troublés et qui garderaient leur vie
durant les images de cette période bouleversée de
leur
existence."
Jean Jaigu
Voir aussi la page Le
déminage de la France après 1945 sur le
site Chemins
de mémoire
